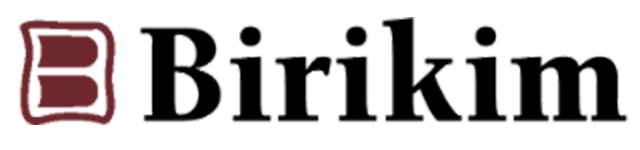Plus qu’une position idéologique parmi d’autres, le nationalisme est la matrice de toute la pensée politique turque contemporaine. La gauche comme la droite, les Turcs comme les Kurdes, les laïcistes comme les islamistes revendiquent haut et fort leur adhésion aux principes nationalistes. Et cela n’a rien de surprenant tant l’idéologie officielle de l’Etat –le nationalisme d’Atatürk- s’impose à tous les acteurs politiques et pétrit, depuis des décennies, l’imaginaire social et politique du pays. Ce nationalisme officiel, aux contours relativement flous, associe autoritarisme élitaire, volonté de façonner la société, aussi « par le haut » qu’à l’image de l’Occident, et culte « du père fondateur » de la République. Ses symboles et ses rites sont marqués par un esprit hiératique et par tout le cérémonial de l’armée turque. Trop « froid » et trop officiel pour devenir à lui seul un facteur puissant de mobilisation sociale, ce nationalisme est néanmoins le point de repère de l’ensemble des acteurs politiques et sociaux. C’est de lui que s’inspirent les différents groupes nationalistes turcs (mais aussi, par mimétisme, les nationalistes kurdes) ; du nationalisme radical aux accents ethnicistes-racistes au nationalisme populaire, tous récupèrent à leurs propres fins ses insignes et ses formes, pour les diffuser dans l’espace public.
Libéral et nationaliste
Les élites libérales ne sont pas étrangères à cette tendance. On peut même parler d’un nationalisme libéral[1], qui a commencé à occuper le devant de la scène publique dans les années 1980, dans le sillage de l’élan de modernisation libérale-conservatrice entamée par M. Turgut Özal[2]. Ce nationalisme opère la synthèse d’éléments idéologiques qui ont commencé à s’imposer en Turquie à partir des années 1980 : libéralisme économique, individualisme mais aussi manifestations d’appartenance culturelle et ethnique et conservatisme des moeurs. S’inscrivant aussi dans l’idéal du nationalisme d’Atatürk qui promet à la Turquie une place au sein des « nations civilisées», le nationalisme libéral a restauré ce projet de modernisation insérer le pays dans l’économie mondiale. Mais si l’Etat était à l’époque considéré comme l’insatnce transformatrice et modernisatrice par excellence, c’est désormais l’idée de réussite personnelle qui est vaorisée.
Le projet fondateur de la République kémaliste chargeait en effet l’Etat -et derrière lui la nation- de rattraper le retard économique et culturel de la Turquie par rapport aux pays plus avancés, afin que l’Etat puisse tenir son rang auprès des puissants de ce monde. Dans ce projet, la société civile ne jouait qu’un rôle symbolique puisque l’occidentalisation devrait être orıentée par les institutions publiques et les élites officielles ou semi-officielles de l’Etat. Mais le coup d’Etat militaire de 1980 et le régime politique qui en résulta ont modifié sensiblement la donne. L’ouverture économique -mais aussi politique et culturelle- au monde, et notamment à l’Occident, fut moins le projet de l’Etat que celui, réclamé et mis en œuvre de manière active et autonome, des nouvelles élites de la société civile. D’un projet collectif à l’échelle de la nation, l’occidentalisation s’est ainsi transformée en une série de projets individuels, sans perdre pour autant sa connotation nationaliste, celle-ci se définissant désormais par la volonté d’atteindre un niveau de vie équivalent à celui des Occidentaux et de faire reconnaître pleinement la Turquie par les puissances occidentales, toujours soupçonnées de mauvaises intentions à son égard.
C’est donc la réussite individuelle des Turcs, assimilées à celles de la Turquie, qui devint pour ces nouvelles élites le symbole du défi lancé par le pays « au monde civilisé ». Les résultats des sportifs turcs dans les compétitions internationales, les succès ou les déboires des artistes turcs dans des manifestations culturelles comme l’Eurovision, les exploits internationaux des entreprises turques ou les succès professionnels des ressortissants turcs vivant à l’étranger devinrent autant d’expressions individuelles d’une saga nationale. Les médias furent le principal vecteur de ce nationalisme libéral et profitèrent de toutes les opportunités offertes par la fin du monopole public sur le secteur audiovisuel (à partir du milieu des années 1980) pour entamer un tournant « people » qui rapprocha le nationalisme libéral du nationalisme populaire, autour de la musique populaire notamment (contrastant avec le nationalisme officiel qui, lui préfère la musique classique, turque et occidentale).
Dans ce contexte, l’adhésion à l’Union Européenne devint pour ces élites libérales bien plus qu’un projet politique : elle résumait avant tout leur désir de changer la société. Pas de la transformer radicalement, puisque leur slogan préféré affirmait qu’il fallait « rester Turc », mais plutôt de façonner la société à leur image, notamment en « civilisant » l’autre Turquie.
L’ "autre Turquie"
Ce nationalisme libéral est porté principalement par les nouvelles couches urbaines dont les membres maîtrisent souvent une ou plusieurs langues étrangères -apprises dans des lycées prestigieux- et ont parfois étudié ou séjourné dans des pays occidentaux, notamment aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne. Dénommés parfois « Turcs blancs », les tenants du nationalisme libéral sont pro-européens, libéraux et insérés dans la mondialisation. Ils se considèrent comme surqualifiés par rapport au reste de la population et estiment que les « autres » Turcs sont une entrave à leur projet d’accession à un niveau de vie et à un environnement sociopolitique équivalent à celui des pays occidentaux.
On aurait pu s’attendre à ce que ces nouvelles élites s’affranchissent de toute considération nationale pour épouser un imaginaire déterritorialisé et cosmopolite. Mais parmi les Turcs qui vivent dans des pays occidentaux depuis de nombreuses années certains affichent un nationalisme de diaspora d’autant plus ostentatoire qu’ils se sentent vulnérables et agressés dans leur pays d’accueil, notamment quand ils sont confrontés à l’image négative des Turcs dans l’imaginaire occidental. Ce rejet accroît leur crispation nationaliste d’une part, et leur haine à l’encontre de « l’autre Turquie » d’autre part, qu’ils jugent responsable de cette image.
Ce mécanisme n’est pas fondamentalement différent chez les élites libérales qui, non sans un certain regret, restent au pays et rêvent de changer la société. Leurs nombreuses réactions dans la sphère publique permettent de mieux comprendre l’influence du nationalisme officiel sur les esprits. Face à l’Occident, elles revendiquent avec force leur identité nationale, se disent « fières » d’être turques et de vouloir le rester. Mais, dans le même temps, ces élites libérales ne sauraient masquer leur ressentiment à l’égard de « l’autre Turquie » - celle des « petites gens » qui vivent dans la pauvreté, l’ignorance et la violence, et qui donnent aux étrangers une image négative du pays. C’est pourquoi elles considèrent les multiples signes de sa présence dans la vie sociale (du foulard[3] aux barbecues dans les jardins publics d’Istanbul) comme autant d’obstacle à la pleine reconnaissance des Turcs par les Occidentaux. Ce sentiment s’est encore accentué avec l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Union Européenne : la méfiance de l’opinion publique européenne est ainsi attribuée par ces élites à la présence de cette « autre Turquie » dans la vie politique (un parti « islamiste » au pouvoir), sociale (statut de la femme dans la société traditionnelle) et économique (une population «peu qualifiée, inculte et pauvre » et qui « fait beaucoup d’enfants»). D’où l’émergence, autant dans la sphère privée que dans la presse, d’une nouvelle sorte de « haine de classe » vis-à-vis de ces populations, les griefs portant non seulement leur manière d’être (paysannes plus que provinciales), mais aussi leur physique (« poilus, courts sur jambe, petit et gros », etc.).
Dans la conjoncture actuelle, marquée par la reprise des hostilités entre l’Etat et le PKK, « le Kurde » joue facilement le rôle cet « Autre » contre lequel les Turcs blancs vivent leur identité. En atteste un éminent représentant du nationalisme libéral, Ertuğrul Özkök[4] , qui vient de rappeler à « ses amis européens que le meurtre d’honneur des jeunes femmes n’est pas un problème de la Turquie mais celui des Kurdes ». Pour ce nationalisme libéral, comme pour le nationalisme radical ethniciste, la violence contre les femmes, les meurtres d’honneur et, plus généralement, le crime organisé et la petite délinquance sont exclusivement attribués à ceux qui vivent « là-bas », à « eux ». Grâce à cette distinction entre « nous » et « eux », les élites libérales espèrent ainsi pouvoir « blanchir » leur identité vis-à-vis du monde occidental et justifier au besoin le recours à des méthodes autoritaires pour civiliser l’ « autre partie » de la société.
Cette haine de classe, de plus en plus « ethnicisée », n’est pas uniquement alimentée par un « souci de présentation » auprès des étrangers. Elle traduit également la crainte pour de nombreuses élites urbaines de voir leur mode de vie menacé si la « populace » réussissait à entrer dans l’espace public et à remettre en cause leur statut et leurs privilèges, en exigeant par exemple d’accéder aux fonctions publiques ou privées jusqu’ici réservées naturellement aux Turcs blancs.
Crainte de déclassement, sentiment d’infériorité face aux pays plus développés, de tels sentiments se manifestent chez les Turcs blancs de différentes manières : valorisation d’un style de vie hédoniste et ostentatoire en vue de se rassurer par le retour médiatique de son image ; « changements d’humeur » brutaux et cycliques envers l’Europe ( tantôt un modèle à suivre, tantôt un « club chrétien ») ; critique d’une société turque « rétrograde », de la classe politique (« une bande de parasites »), et finalement, des « Turcs blancs » eux-mêmes, qui continuent malgré tout de vivre en Turquie. Le nationalisme libéral est au fond l’expression d’un désespoir.
La Vie des Idées, juillet-août 2006
[1] Nous adoptons la terminologie proposée par Tanil Bora dans son article « Nationalist Discourses in Turkey », The South Atlantic Quarterly, 102 :2/3, Duke University Press, 2003.
[2] Premier ministre (1983-1999) puis président de la République turque (1989-1993). Il est considéré comme l’artisan du programme d’ajustement structurel, de l’ouverture économique et sociale, de l’avènement d’un conservatisme libéral et du second ancrage européen de la Turquie.
[3] Autrefois ce fût le pantalon bouffant du paysan, le port du fez, ou à d’autre moment le port de la moustache…
[4] Ertugrul Özkök, « Bu da asıl Kürt sorunu », Hürriyet, 17 juin 2006.